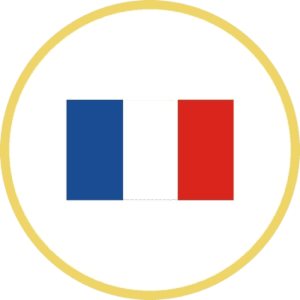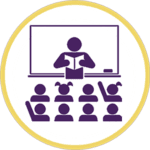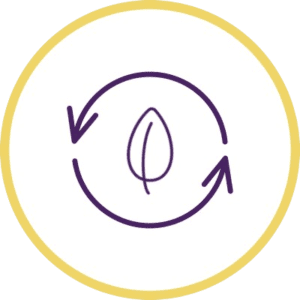La métacognition, c’est la compétence à se poser des questions sur ses façons de faire pour effectuer une tâche, répondre méthodiquement à une question, apprendre une leçon, ou trouver la solution à un problème. Elle permet de mettre en place une méthode pour planifier ses actions (étape après étape), s’autoévaluer tout au long de la tâche (contrôle, vérification, et réajustement si besoin), et de prendre le temps de mémoriser le procédé suivi afin de le reproduire sur d’autres tâches ensuite.
À l’école, la métacognition demande à l’élève de s’observer, de chercher à connaître son fonctionnement cognitif, et de pouvoir gérer de manière autonome les fonctions exécutives nécessaires à l’exécution d’une tâche ou la résolution d’un problème (activation, mémoire de travail, planification, inhibition, flexibilité mentale). La métacognition permet en s’observant de développer les outils métacognitifs comme l’organisation de sa tâche, la prévision, la hiérarchisation de l’information, le contrôle de ses stratégies de résolution de problème ou de mémorisation, la vérification à chaque étape, etc.
“On peut aussi définir la métacognition comme le regard qu’une personne peut porter sur sa démarche mentale et ce, avant, pendant, après l’apprentissage, afin de planifier, évaluer, ajuster et vérifier son processus.”
(Lafortune, Jacob et Hebert, 2000)
Selon Vygotski, la métacognition fait prendre conscience à l’élève de ce qu’il fait, de ce qu’il pense et il peut ainsi évaluer l’efficacité de ses actions (physiques et mentales). C’est en quelque sorte la représentation que l’élève se fait des connaissances déjà acquises et de la façon dont il s’en sert. Une des clés de la réussite scolaire, c’est justement la capacité à évaluer, estimer les connaissances et comprendre les raisonnements engagés pour utiliser ces connaissances et en construire de nouvelles : apprendre à apprendre en sachant comment on apprend !
En préambule à cette compétence, il est indispensable de comprendre comment fonctionne notre cerveau : non seulement pour les élèves, mais également pour les enseignants et les parents. Sur notre site, vous pouvez retrouver une vidéo de vulgarisation sur le sujet qui vous apportera quelques notions de base.
Pour inciter ce comportement métacognitif chez l’élève, on le favorisera grâce à un questionnement ciblé.

Pour installer la métacognition comme socle d’enseignement, un des outils pertinents pour la faciliter, c’est la méthode de l’enseignement explicite. Cette méthode est utilisée par les enseignants, au sein des classes, que ce soit en primaire comme dans le secondaire. Mais elle a aussi sa place dans le supérieur, comme à la maison, pour soutenir le travail personnel de consolidation. On vous en parle bientôt !
By CréaDop