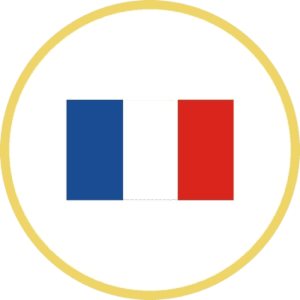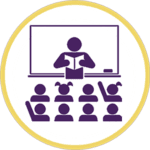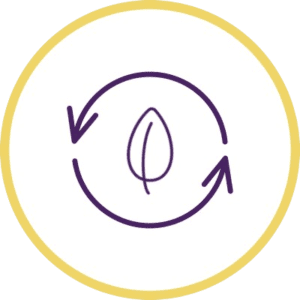Les neurosciences sont l’étude de l’ensemble du système nerveux : le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, à des échelles différentes, et qui définissent ainsi un champ de recherche multidisciplinaire. À savoir que notre système nerveux s’étudie également à deux niveaux puisque nous possédons un système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière), et un système nerveux périphérique (l’ensemble des nerfs qui circulent dans tout notre corps). Derrière cette définition théorique des neurosciences, se cache un domaine pointu et passionnant puisque le système nerveux dirige énormément de choses dans notre corps : du fonctionnement du cerveau jusqu’à sa communication avec notre corps, en passant par le développement de notre raisonnement, de notre personnalité ou encore la gestion de notre coordination. On peut dire que le système nerveux est en lien avec l’ensemble de notre corps.
Quel est concrètement l’objet des neurosciences ? Étudier la structure de notre système nerveux, la manière dont il fonctionne, et son lien direct avec les autres parties de notre corps, tel est le défi des neurosciences. Auparavant, les neurosciences étaient un domaine réservé aux chercheurs et aux scientifiques. Mais on s’est rendus compte qu’elles pouvaient nous apprendre beaucoup sur d’autres domaines comme l’apprentissage, la psychologie, etc.
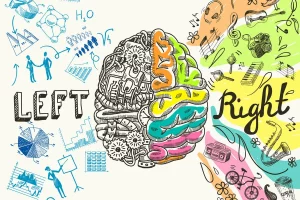 Depuis l’apparition de l’imagerie cérébrale en 1973 avec l’invention de l’IRM et de l’imagerie par ordinateur, les neurosciences ont connu un élan de découvertes et d’avancées incroyables. Ces technologies ont en effet permis d’observer le cerveau en détails, c’est ce qu’on appellera la neuro-imagerie structurelle. Mais aussi, à partir des années 90, d’analyser le cerveau en activité réalisant des tâches cognitives (parler, compter, penser…), afin de détecter la zone du cerveau qui s’active lors de ces tâches. C’est ce qu’on nommera la neuro-imagerie fonctionnelle.
Depuis l’apparition de l’imagerie cérébrale en 1973 avec l’invention de l’IRM et de l’imagerie par ordinateur, les neurosciences ont connu un élan de découvertes et d’avancées incroyables. Ces technologies ont en effet permis d’observer le cerveau en détails, c’est ce qu’on appellera la neuro-imagerie structurelle. Mais aussi, à partir des années 90, d’analyser le cerveau en activité réalisant des tâches cognitives (parler, compter, penser…), afin de détecter la zone du cerveau qui s’active lors de ces tâches. C’est ce qu’on nommera la neuro-imagerie fonctionnelle.
Nous l’avons vu plus haut, le champ de recherches en matière de neurosciences est très large et regroupe plusieurs disciplines scientifiques que nous pouvons classer en 4 grands groupes :

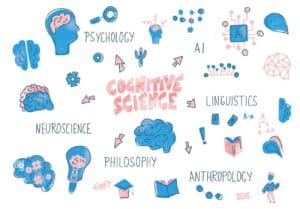 Les sciences cognitives : Quelles disciplines regroupe-t-on sous l’appellation sciences cognitives ? Dans une dimension cognitive, les neurosciences s’intéressent à : – Notre sensibilité affective et émotionnelle (neurosciences affectives) – Nos comportements et éventuellement leur lien avec notre génétique (neurosciences comportementales) – L’évolution de notre apprentissage, de notre mémoire, et l’acquisition de nos savoirs et de certains de nos réflexes (neurosciences cognitives) – La psychologie sociale : émotions, perception sociale, empathie… – Notre expression verbale : neurolinguistique, langage, Aire de Broca, acquisition du langage, perception de la parole
Les sciences cognitives : Quelles disciplines regroupe-t-on sous l’appellation sciences cognitives ? Dans une dimension cognitive, les neurosciences s’intéressent à : – Notre sensibilité affective et émotionnelle (neurosciences affectives) – Nos comportements et éventuellement leur lien avec notre génétique (neurosciences comportementales) – L’évolution de notre apprentissage, de notre mémoire, et l’acquisition de nos savoirs et de certains de nos réflexes (neurosciences cognitives) – La psychologie sociale : émotions, perception sociale, empathie… – Notre expression verbale : neurolinguistique, langage, Aire de Broca, acquisition du langage, perception de la parole
Aujourd’hui, on se rend compte que les neurosciences peuvent expliquer beaucoup de choses, et dans de nombreux domaines. De cette généralisation, émergent des disciplines récentes qui viennent s’ajouter, comme la neuro-philosophie par exemple. Après avoir fait l’état des lieux des différents champs d’application en matière de neurosciences, nous nous focaliserons dans cet article sur les neurosciences cognitives et notamment leur application dans le domaine de l’apprentissage scolaire.
Pour commencer, quel est le sens du terme scientifique cognitif ? Les neurosciences cognitives consistent en l’étude du fonctionnement de la pensée. Plus précisément, il s’agit de comprendre la manière dont notre cerveau assimile une information, la traite puis la retient. Mais aussi d’étudier d’autres grandes fonctions du cerveau comme le raisonnement, le langage, la mémoire, l’attention, etc.
Quelles sont les sciences cognitives ? La dimension cognitive des neurosciences est à la croisée d’autres disciplines telles que la psychologie, la philosophie, les neurosciences computationnelles, et bien-sûr les sciences cognitives. Nous allons dans la suite de cet article nous focaliser sur le lien étroit qu’il existe entre les neurosciences cognitives et notre manière d’apprendre.

Pourquoi choisir les neurosciences pour nous aider à comprendre notre apprentissage ?
Comme elles étudient le fonctionnement et les réactions du cerveau lors des différentes activités (réflexion, attention, mémorisation…), les neurosciences cognitives se montrent très intéressantes pour comprendre nos mécanismes d’apprentissage.
Grâce aux nombreuses avancées des neurosciences en matière de pédagogie, nous savons maintenant que pour bien apprendre, notre cerveau a besoin entre autres :
– De récompense : Lorsque nous obtenons une bonne réponse par exemple, ou que nous avons réussi à apprendre quelque chose, notre cerveau nous envoie un message positif. Il peut ainsi relier ce moment d’apprentissage à quelque chose d’agréable, et nous donner envie de réitérer l’expérience, pour obtenir à nouveau ces sensations positives. On peut retrouver ce phénomène par exemple avec le jeu. C’est pour cela que les jeux vidéos ont autant de succès, plus nous validons de niveaux, plus nous satisfaisons notre système de récompense. Alors pourquoi pas apprendre en s’amusant ? Retrouvez notre article à ce sujet juste ici ! En matière d’apprentissage scolaire, féliciter son enfant est aussi important. Lui dire qu’il a bien travaillé, progressé, lui permettra de constater le chemin parcouru et le motivera pour la suite.
– De motivation : Un élément clé pour apprendre et mémoriser durablement : créez un univers agréable, transformez les temps d’apprentissage en des moments ludiques, donnez-vous des buts précis à atteindre, observez vos progrès… Toutes ces idées vous permettront de gagner en motivation ! Maintenant que vous êtes motivés, il faut le rester ! En effet, prenons l’exemple d’un enfant qui fait ses devoirs. Se montrer disponible pour l’aider si besoin et répondre à ses éventuelles questions, lui permettra de ne pas rester en difficulté s’il se retrouve bloqué à certains moments. Car à l’inverse, s’il met trop de temps à faire ses devoirs, il risque de finir par se démotiver.
– D’attention : Être attentif lors de l’apprentissage permet au cerveau d’enregistrer de manière optimale une nouvelle information lors de sa phase d’encodage (première étape de la mémorisation). D’après Stanislas Dehaene, neuroscientifique, l’attention permettrait au-delà de bien mémoriser, d’apprendre plus vite. Si le sujet de la mémorisation vous intéresse, n’hésitez pas à consulter notre article “Comment mémoriser plus facilement”.
– D’exercice physique :  Selon les neurosciences cognitives, pratiquer une activité physique pourrait rendre jusqu’à 30% plus efficace notre apprentissage et notre mémorisation. Comment est-ce possible ? Tout d’abord, il faut savoir que notre cerveau est petit, mais qu’il consomme beaucoup d’énergie, en majorité sous forme de glucose. Mais, le glucose est considéré par notre cerveau comme “un déchet”, qu’il parvient à éliminer grâce à : l’oxygène. Et forcément, quand on bouge, on s’oxygène ! Ainsi, pratiquer une activité physique régulière permet de maintenir une bonne oxygénation de notre cerveau. Mais pas que ! Faire du sport active aussi le cervelet, qui lui-même réactive le préfrontal, chef d’orchestre de notre cerveau, rien que ça !
Selon les neurosciences cognitives, pratiquer une activité physique pourrait rendre jusqu’à 30% plus efficace notre apprentissage et notre mémorisation. Comment est-ce possible ? Tout d’abord, il faut savoir que notre cerveau est petit, mais qu’il consomme beaucoup d’énergie, en majorité sous forme de glucose. Mais, le glucose est considéré par notre cerveau comme “un déchet”, qu’il parvient à éliminer grâce à : l’oxygène. Et forcément, quand on bouge, on s’oxygène ! Ainsi, pratiquer une activité physique régulière permet de maintenir une bonne oxygénation de notre cerveau. Mais pas que ! Faire du sport active aussi le cervelet, qui lui-même réactive le préfrontal, chef d’orchestre de notre cerveau, rien que ça !
– De sommeil : Même quand nous dormons, notre cerveau travaille ! Les neurosciences ont démontré que la nuit, notre cerveau reprenait nos entraînements de la journée, autant sportifs qu’intellectuels. Il “révise” tout seul ! Ce processus lui permet de créer ainsi de nouveaux réseaux de connexions entre les neurones. La durée idéale de sommeil est de 8 heures pour un adulte et de 9 à 12 heures pour un enfant âgé de 6 à 12 ans.

Chez Créadop, nous sommes créateurs d’outils pédagogiques. Depuis le début, l’apprentissage doit être, selon nous, guidé par les neurosciences. Car si on respecte le fonctionnement du cerveau, il sera forcément plus facile d’apprendre !
C’est ainsi qu’avec Frédérique, orthopédagogue de métier, qui s’était largement documentée sur le sujet, notamment sur la mémoire, nous avons décidé de lancer le premier outil de révision du programme scolaire qui respecte le fonctionnement et le rythme de notre cerveau. Si vous avez envie d’en savoir plus à ce sujet, n’hésitez pas à regarder notre vidéo de formation passionnante sur le fonctionnement de la mémoire !
Eleph’Ant a été conçu pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, scolarisés en classe de CP jusqu’à la 6ème (1ère année du Collège). Il leur permet de planifier leurs révisions tout en respectant une répétition régulière, mais aussi des temps de repos. La répétition s’espace progressivement en fonction de la mémorisation de l’enfant : quotidienne, hebdomadaire, puis mensuelle. C’est cette méthode qui permet d’apprendre facilement, et pour longtemps.
Un travail de fourmis pour une mémoire d’éléphant !
Vous souhaitez en savoir plus à propos de notre outil ? Rendez-vous sur la page Eleph’Ant !
Notre jeu pédagogique s’adapte aux classes de CP – CE1– CE2 – CM1 – CM2 – et 6e.
By CréaDop